- Accueil
- Publications
- Tous les domaines
- Droit civil & familial
- Droit de l'immobilier
- Droit de la consommation
- Droit du travail
- Droit des entreprises
- Droit des nouvelles technologies
- Droit des étrangers
- Droit international
- Droit administratif & fiscal
- Droit pénal
- Droit routier
- Droit de la santé
- Droit du sport
- Forum Juridique
- Tous les forums
- Droit civil & familial
- Droit de l'immobilier
- Droit de la consommation
- Droit du travail
- Droit des entreprises
- Droit des nouvelles technologies
- Droit des étrangers
- Droit international
- Droit administratif & fiscal
- Droit pénal
- Droit routier
- Droit de la santé
- Droit du sport
- Posez votre question
- Créez votre blog juridique
- Articles
- Blogs
Quels sont les moyens de Contester une cassation

9 rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles
02.61.53.08.01
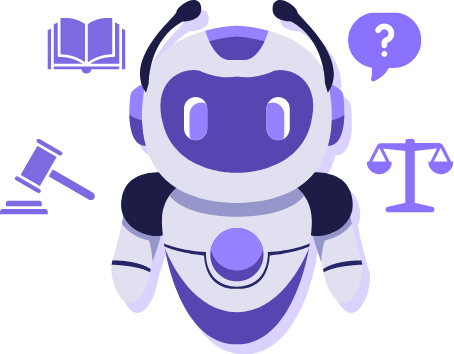
Une question juridique ?
Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr
J'ai une décision de la cour de cassation qui me semble entachée d'erreur matérielle, voire d'erreur procédurale.
Quelle solution me conseillez vous, recours au ministre, à l'agent judiciaire de l'état, au TGI, à la CEDH,rabat d'arrêt, ou autre si elle existe.
J'ai développé un argumentaire que je vous joins.
Excusez moi, il est un peu long....
EXPOSE DE LA DEMANDE
Les faits:
En décembre 2006, la société ICI Paints Déco France (dont j’étais délégué du personnel depuis le 30 mai 2006 pour une durée de 4 ans) décidait de fermer son établissement de Marseille ou j’étais salarié.
PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Le 1er mars 2007, mon employeur ne me fournissait plus de travail.
Le 27 mars 2007, l’inspecteur du travail refusait d’accorder mon licenciement Le 13 septembre 2007, le Ministre du travail confirmait ce refus
Le 29 juin 2010 le tribunal administratif refusait également l’autorisation de licencier
Le 24 janvier 2012 la cour d’appel administrative faisait de même
Le 1er aout 2013 le conseil d’état rejetait le pourvoi de l’employeur
PROCEDURE EN RESILIATION JUDICIAIRE
30 octobre 2007 : je saisis le Conseil des Prud’hommes de Marseille d’une demande en résiliation judiciaire de mon contrat de travail aux torts de l’employeur
Cette demande comportait plusieurs volets. La plus importante était la reconnaissance de la violation de mon statut protecteur dont je bénéficiais depuis le 30 mai 2006, date de mon élection comme délégué du personnel pour une durée de 4 ans. Le montant de l’indemnité demandée était de 110 000€. C’est le traitement de cette demande qui pose problème.
10 janvier 2008 : bureau de conciliation.
6 juin 2008 :l’affaire est mise en audience une première fois. A la demande de la partie adverse, l’audience est reportée au 21 janvier 2009. Sa demande principale était déjà un sursis à statuer en attendant une décision administrative. Dans nos conclusions, nous avions demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui par ailleurs a été rompu le 1er septembre 2008 pour refus de mutation. En effet,la société ayant obtenu de l’inspection du travail la reconnaissance de perte d’établissement distinct du site de Marseille en date du 22 mai 2008 arguait de la fermeture du site en aout 2007 pour se passer de l’accord de l’inspection du travail et me licencier pour faute lourde.
4 mai 2009 : le Conseil des Prud’hommes constate qu’il ne peut se départager et décide de faire appel à un juge de départage. L’audience est fixée au 10 novembre 2009.
1er décembre 2009 : décision de départage, mais alors qu’il était demandé au principal la résiliation aux torts de l’employeur, le juge conclut à la nullité du licenciement intervenu le 1er septembre 2008 privant ainsi d’effet ma demande de résiliation judiciaire.
9 décembre 2009 :l’employeur fait appel de cette décision. Je fais également appel le 4 janvier 2010 car la méconnaissance du statut protecteur n’était pas prise en compte dans sa totalité du fait de la nullité du licenciement.
10 mai 2010 : première audience d’appel. L’employeur n’avait pas conclu et s’est borné à demander à nouveau un sursis à statuer ainsi qu’un jugement en formation collégiale.
14 avril 2011 : seconde audience en formation collégiale (programmée un an plus tard). En Mars 2011 l’employeur n’avait toujours pas déposé ses conclusions et j’ai adressé un courrier à Mr le Président de la Cour d’appel le 14 mars, lui demandant d’intervenir. Les conclusions nous sont parvenues le 8 avril 2011.
16 juin 2011 :Le sursis à statuer est accordé,précisant que la décision administrative à venir était de nature à influer sur le jugement.
24 janvier 2012 : la Cour d’appel administrative rejette la demande de la partie adverse et confirme le refus de licenciement.
24 mai 2012 : troisième audience de la Cour d’appel, alors que l’employeur se pourvoyait en Conseil d’état le 26 mars 2012.
26 juillet 2012 : la Cour d’appel, dans la même composition, juge cette fois que « l’arrêt du Conseil d’état à intervenir n’est pas de nature à influer sur la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer. »
Il s’est donc passé plus de 2 ans et demi avant d’obtenir un second jugement (du 1er décembre 2009 au 26 juillet 2012).
25 septembre 2012 : Cet arrêt de la cour d’appel ne prenant pas en compte la totalité de l’indemnité de méconnaissance du statut protecteur, je me pourvoyais en cassation le ce que faisait également l’employeur le 2 octobre 2012.
27 novembre 2013 : La cour de cassation confirme que la requête de l’employeur est infondée, mais maintient la date du 22 novembre 2008 à retenir pour juger de la fixation de l’indemnité de méconnaissance du statut protecteur, malgré la date de saisine du 30 octobre 2007.
PROCEDURE EN REFERE
Parallèlement et consécutivement à mon licenciement pour faute lourde du 1er septembre 2008, sans accord de l’inspecteur du travail et alors que j’étais toujours salarié protégé, j’ai attrait mon employeur en référé devant le conseil des prud’hommes de Marseille le 31 octobre 2008.
La réintégration a été ordonnée le 15 janvier 2009 et effective début février 2009 jusqu’à un nouveau licenciement pour la même faute le 26 mai 2009.
La cour d’appel d’Aix saisie par l’employeur a reconnu que ma réintégration était devenue impossible le 29 juin 2009.
PROCEDURE AU PENAL
Appuyant la démarche de l’inspection du travail qui a porté l’affaire devant le TGI de Nanterre sous n° d’enregistrement 08 323 45089 en décembre 2008, je me suis porté partie civile avec demande de dommages intérêts en application de l’article L1235-11 du code du travail.
L’affaire n’a été jugée que le 5 septembre 2011, soit 3 ans après le dépôt de plainte.
Le juge a reconnu l’élément légal et matériel du délit d’entrave mais a relaxé l’employeur pour défaut d’intentionnalité, alors que le non respect des obligations légales suffit à caractériser l’intention.
Il m’a ainsi privé de ma demande de dommages et intérêts. Je n’ai obtenu copie de cette décision le 10 janvier 2012 qu’à ma demande expresse.
Compte tenu de cette relaxe, il était inutile que je poursuive l’employeur.
J’ai attrait de nouveau l’employeur devant le TGI de Nanterre pour le nouveau licenciement du 26 mai 2009 par un dépôt de plainte le 17 mai 2012, enregistrée sous le n° 12 156 000 257.
Après mes relances, il m’a été répondu le 28 mars et le 30 juillet 2013 que l’affaire était en cours, et c’est toujours le cas à ce jour, l’enquête étant diligentée depuis le 6 septembre 2013.
LE DROIT :
D’une part
-L'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue () dans un délai raisonnable () par un Tribunal () qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle"
La jurisprudence Magiera contre ministre de la justice rendue par le Conseil d'Etat le 28 juin 2002 prévoit la réparation du préjudice moral et matériel causé par un délai non raisonnable d'une procédure.
Cet arrêt ne concerne pas seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi plus largement, de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable conformément à l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. L'existence d'un tel délai s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce
-L’article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme prévoit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
-L’article 7 de la déclaration universelle des droits de l’homme précise :
« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. »
D’autre part
-L’article L141 du code de l’organisation judiciaire prévoit :
« L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
DISCUSSION
Ma requête porte sur la violation de l’article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la violation de l’article 6 de la CDEH associé à l’article 13 et la violation de l’article L141 du code de l’organisation judiciaire.
1)Pour délai non raisonnables de la juridiction administrative
2)Pour un déni de justice de la cour d’appel et délais déraisonnables
3)Pour non application d’une jurisprudence établie
4)Pour faute lourde de la cour de cassation
5)Pour non présentation du rapport de l’avocat général associé à une charge de travail non compatible avec une justice équitable.
6)Pour manque d’information et délai non raisonnable du tribunal de grande instance
Pour une plus grande clarté de l’exposé, les différentes violations sont analysées dans l’ordre chronologique, bien que la plus importante à mon sens soit la faute lourde la Cour de cassation.
DELAI NON RAISONNABLE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
La juridiction administrative a connu un délai de 6 ans et demi pour confirmer la décision de l’inspection du travail du 27 mars 2007.
Si le délai de décision du ministre est acceptable (6 mois), il n’en est pas de même de ceux du tribunal administratif qui a mis près de 3 ans à se prononcer, de la Cour d’appel qui a mis près de 2 ans malgré notre demande expresse du 30 juin 2011 et du conseil d’état qui a mis plus d’un an.
-Tribunal administratif : 2 ans et 8 mois. (Saisi le 7 novembre 2007, décision rendue le 29 juin 2010)
-Cour d’appel administrative : 1 an et 5 mois. (Saisie le 16 aout 2010, décision rendue le 24 janvier 2012)
-Conseil d’état : 1 an et 4 mois (uniquement dans le cadre de la procédure d’admission préalable. Saisi le 5 avril 2012, rejet de la demande le 1er aout 2013).
Alors que cette affaire n’avait rien de compliqué et qu’elle se situait dans le cadre d’un refus d’autorisation de licencier pour lequel la Cour Européenne réclame la plus grande célérité (Buchholz c.Allemagne §52;Frydlender c.France[GC],§45), et malgré notre relance du 30 juin 2011 (PJ 19), il aura fallu attendre plus de 5 ans avant d’avoir une décision d’appel.
Ces délais administratifs sont d’autant plus inacceptables qu’ils ont permis à la partie adverse d’obtenir un sursis à statuer dilatoire me causant un préjudice énorme par la perte du bénéfice de la jurisprudence en cours sur la période prise en compte pour la méconnaissance du statut protecteur.
Vous trouverez en pièces jointes les récapitulatif des actions relevées sur le site SAGACE pour le Tribunal administratif (PJ 16) et la Cour administrative d’appel.
DENI DE JUSTICE DE LA COUR D’APPEL ET DELAIS DERAISONNABLES
La Cour d’appel a failli à sa mission de service public en disposant de délais extrêmement longs entre chaque audience (11 mois pour obtenir une formation collégiale) et en accordant un sursis qu’elle juge ensuite infondé (11 mois à nouveau perdus).
Ces délais de 11 mois entre chaque audience sont déraisonnables. Les conclusions étant déjà établies, la Cour ayant parfaite connaissance des méthodes dilatoires de l’employeur et encore une fois alors que nous sommes dans un cas ou la Cour Européenne réclame la plus grande célérité.
La demande de formation collégiale, puis le sursis refusé par le juge de départage et ensuite accordé par la cour d’appel est indéniablement une méthode dilatoire de l’employeur.
Or, même si les autorités nationales ne peuvent pas être tenues pour responsables du comportement d’un défendeur, les méthodes dilatoires utilisées par l'une des parties ne les dispensent pas de leur obligation d'assurer le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable (Mincheva c.Bulgarie, §68)
Vous pourrez constater que ces délais sont uniquement du fait de la Cour d’appel.
Outre ces délais extrêmement longs, la cour d’appel a commis un déni de justice en prononçant le sursis à statuer alors que le jugement de la résiliation judiciaire était indépendant de la solution du litige pendant devant la cour d’appel administrative.
C’est ce qu’elle a retenu dans sa troisième audience et qu’a confirmé la cour de cassation en répondant au premier moyen de la partie adverse :
« Mais attendu que le salarié invoquait à l’appui de sa demande des griefs postérieurs à la décision de l’inspecteur du travail, et retenu que ceux ci justifiaient , à eux seuls, la résiliation judiciaire du contrat de travail, en sorte que l’issue du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille était sans incidence sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d’appel a, sans se contredire, fait l’exacte application des textes et principes susvisés. »
En effet, la faute invoquée auprès de la Cour d’appel était le manque de fourniture de travail qui à lui seul justifiait la résiliation aux torts de l’employeur.
Cette faute, commise avant même que l’inspecteur du travail ne se prononce en refusant d’accorder le licenciement, était donc sans aucune relation avec la procédure administrative provoquée par l’employeur.
D’autre part, nos conclusions montraient bien à la cour l’attitude dilatoire de la partie adverse, précisant que lors de la première audience elle n’avait même pas conclu sur le fond, et le manque absolu de rapport entre la décision administrative et judiciaire, compte tenu de la multitude de reproches faits à l’employeur, antérieurs à la demande d’autorisation de licencier
C’est ce que la cour d’appel a d’abord nié lors de sa seconde audience et a ensuite reconnu lors de la troisième audience dans sa même composition.
En effet, la même cour d’appel a pu dire au final et sans aucun autre commentaire : « l’arrêt du conseil d’état à intervenir n’est pas de nature à influer sur la solution du litige.»
Alors qu’un an plus tôt, elle avait sursis à statuer au motif que : « la question de savoir si la société a effectivement manqué à cette obligation (de fournir du travail) …. Ainsi, la solution de l’instance prud’homale dépend de l’issue de la procédure engagée devant la juridiction administrative. »
Ainsi, la cour d’appel reconnaît son refus de statuer et a abusé de son pouvoir discrétionnaire, ce qui constitue un déni de justice caractérisé.
En effet, si le sursis à statuer appartient au pouvoir discrétionnaire de la cour, l’abus de ce pouvoir constitue un déni de justice.
Ce déni de justice a eu d’énormes conséquences sur la suite du procès, puisque sans ces 2 ans perdus en atermoiements, le pourvoi en cassation aurait été jugé alors que la jurisprudence sur la prise en compte de la date de saisine pour déterminer la méconnaissance du statut protecteur ne faisait encore aucun doute (dernière jurisprudence favorable le 13 février 2013 cassant un jugement d’appel de septembre 2011 , celui me concernant aurait du intervenir en juin 2011).
La procédure a débuté le 30 octobre 2007 et n’est pas encore terminée à ce jour, puisque pendante devant la Cour d’appel de Montpellier.
LE DELAI GLOBAL PRIS DANS SON ENSEMBLE EST DE PLUS DE 6 ANS
Il est beaucoup trop long pour une affaire de cette nature et la simple constatation de ce délai global suffit à le qualifier de "non raisonnable".
La Cour Européenne a d’ailleurs mis l’accent sur la célérité nécessaire dans ce type de jugement concernant le droit du travail.
Elle précise que les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (Vocaturo c.Italie, §17) que soit en jeu le licenciement qu’il conteste (Buchholz c.Allemagne §52;Frydlender c.France[GC],§45),sa suspension(Obermeier c.Autriche, §72),sa mutation(Sartory c.France, §34)ou sa réintégration (Ruotolo c.Italie, §17), ou qu’il y ait un enjeu financier capital (Doustaly c.France,§48)
L'AFFAIRE N'EST PAS COMPLEXE: Il s'agissait simplement de juger de la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé aux torts de l’employeur.
La solution était évidente puisque l’employeur m’a dispensé de travail avant même que l’inspection du travail n’ai refusé l’autorisation de me licencier.
D’autre part, la jurisprudence nombreuse et constante en la matière justifiait à elle seule un traitement rapide du dossier.
Nous n’avons rien fait qui puisse prolonger la procédure, nous avons seulement usé de nos droits de recours et cet usage ne peut pas nous être reproché, sans partialité. Bien au contraire, nous avons essayé de faire accélérer cette procédure:
En revanche, les juridictions judiciaires ont commis des « délais de latence » entre chaque acte tel que repris ci dessous :
-11 mois pour obtenir une décision collégiale (entre le 10/5/2010 et le 14/4/2011)
-11 mois de sursis à statuer non justifiés (entre le 16/6/2011 et le 24/5/2012)
Le préjudice direct et certain de ces 2 ans de délais perdus en atermoiements se retrouve dans la décision de cassation qui me prive d’une indemnité de méconnaissance du statut protecteur du 22 novembre 2008 au 30 novembre 2010.
En effet, s’il n’y avait pas eu ces dysfonctionnements, le pourvoi en cassation aurait été jugé alors que la jurisprudence était constante sur la prise en compte de la date de saisine pour déterminer la méconnaissance du statut protecteur (dernière jurisprudence favorable le 13/2/2013 N°11-26913 cassant un jugement d’appel de septembre 2011, celui me concernant aurait du intervenir en juin 2011).
REFUS D’APPLICATION D’UNE JURISPRUDENCE ETABLIE
La cour d’appel motive son arrêt de la sorte :
« Mr Brasseur a droit au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait du percevoir entre la date de rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, soit du 1er septembre au 22 novembre 2008 »
Je rappelle qu’au 30 octobre 2007, date de ma demande, je bénéficiais d’une protection jusqu’au 30 novembre 2010 et non jusqu’au 22 novembre 2008 comme indiqué par la Cour d’appel.
Cette motivation datée du 26 juillet 2012 est contraire à la jurisprudence établie par la Cour de cassation dont la dernière date du 13 février 2013.
Il y a là un refus d’appliquer la loi dans son intégralité en ne prenant pas en compte les conséquences de son application et qui constitue une faute grave, faute dont la définition juridique est :
« Celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y ait pas été entraîné. »
En effet, la Cour d’appel ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, et la sanction n’ayant aucun rapport avec la motivation, la loi n’est effectivement pas appliquée.
D’autre part, ces agissements constituent un manquement au principe d’égalité devant la loi et violent l’article 7 de la déclaration universelle des droits de l’homme qui précise :
« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. »
FAUTE LOURDE DE LA COUR DE CASSATION
Pour bien comprendre la faute de la Cour de Cassation, il faut connaître les effets différents du licenciement nul et de la résiliation judiciaire dans le cas d’un salarié protégé.
Licenciement nul : le salarié a droit à une indemnité de méconnaissance de son statut protecteur qui court jusqu’à l’expiration du mandat en cours au jour du licenciement. ( 12-12738 du 11/6/2013, 09-41507 du 1/6/2010, 05-44256 du 20/6/2006, 04-40901 du 10/5/2006)
Résiliation judiciaire : le salarié a droit à une indemnité de méconnaissance de son statut protecteur qui court jusqu’à l’expiration du mandat en cours au jour de la saisine du conseil des prud’hommes. (11-26913 du 13 février 2013, 11-16044 du 19 décembre 2012, 09-43206 du 4 mai 2011, 07-45344 du 4 mars 2009)
La Cour d’appel avait précédemment bien établi que la résiliation judiciaire était acquise et la cour de cassation ne revient pas sur cette décision mais n’en tient pas compte.
« Mais attendu qu’ayant relevé que ………que la gravité de ces manquements justifiait la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé. »
En effet, dans toutes les analyses des moyens de l’employeur, la Cour de cassation met l’accent sur la justification indiscutable de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et confirme donc que nous sommes bien dans ce cas en fixant finalement la date de résiliation au jour du licenciement du 1er septembre 2008, ce qui est logique.
Il est d’ailleurs constant qu’en cas de demande de résiliation judiciaire, ce n’est que si cette demande est refusée que le juge doit examiner le bien fondé de la nullité du licenciement, la date propre du licenciement ne servant qu’à fixer la date de fin du contrat. (pourvoi : 11-19641 du 12/6/2012, 07-45689 du 7/12/2011, 04-43663 du 15/5/2007)
Mais, la Cour de cassation retient les conséquences liées à un licenciement nul et non celles liées à la résiliation judiciaire. Ainsi elle ne répond pas aux critères de sa fonction.
En effet, la cour de cassation reprend la motivation de la Cour d’appel ;
« Mais attendu que la perte de la qualité d’établissement du site de Marseille, reconnue le 22 mai 2008 par l’autorité administrative, ayant entrainé la fin du mandat de membre du comité d’établissement exercé par l’intéressé, la cour d’appel a décidé à bon droit, le salarié bénéficiant de la protection de 6 mois prévue pour les anciens élus à compter de la cessation de leur fonctions, que l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur correspondait aux salaires que l’intéressé aurait perçus entre son licenciement et la période de protection (point final) ; que le moyen n’est pas fondé. »
Mais elle tronque cette motivation en ne reprenant pas le texte intégral qui précise : « au jour de sa demande ». Cette précision, pourtant capitale, ne figure plus sans aucune explication dans la motivation sur le moyen unique pris dans sa quatrième branche.
Elle commet un faux intellectuel par omission ou une erreur matérielle en rapportant des déclarations incomplètes de la cour d’appel.
Ces faits caractérisent la faute lourde définie par les textes : « celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y ait pas été entraîné. »
Ainsi, en déformant la motivation de la Cour d’appel, la Cour de cassation entérine la violation de l’article 7 de la déclaration universelle des droits de l’homme commise par la Cour d’appel.
Elle ne craint pas alors de dire que la Cour d’appel a conclu « à bon droit », sans remettre en cause l’erreur matérielle commise dans le calcul de la fin de période de protection quand elle disait :
« Indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur : Monsieur Brasseur a droit au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait du percevoir entre la date de la rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, soit du 1er septembre au 22 novembre 2008, 5969.60 euros »
L’erreur procédurale est certaine.
En effet, l'article 604 du Code de procédure civile fixe bien comme obligation procédurale à la Cour de Cassation "de censurer les non conformités des jugements qu'il attaque aux règles de droit."
En d'autres termes, l'obligation de la Cour de Cassation consiste à effacer toute erreur de droit commise par la juridiction de fond sur des faits constatés.
Si malgré tout, une erreur de droit subsiste et entache donc la décision attaquée faute pour la Cour de Cassation d'avoir laissé une telle erreur, la Haute Juridiction commet bien par ce manquement, une erreur de nature procédurale puisqu'elle ne satisfait pas alors à l'obligation qui lui est assignée par l'article 604 du CPC.
DEFAUT DE RAPPORT DE L’AVOCAT GENERAL ET CHARGE DE TRAVAIL INCOMPATIBLE AVEC UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Il a été porté à notre connaissance le rapport du conseiller rapporteur, mais celui ci était incomplet, ne traitant pas de notre demande concernant l’application de la jurisprudence concernant la méconnaissance du statut protecteur.
Nous avons demandé (personnellement et par l’intermédiaire de notre avocat) à obtenir le rapport de l’avocat général qui nous aurait éclairé sur le sens de la décision, mais ce rapport n’a pas été établi, comme « c’est la coutume dans des cas comme le vôtre » m’a t il été répondu.
Cependant la charte de la procédure devant la cour de cassation précise dans son 1er paragraphe sur L’exercice du droit à l’information :
« Chaque partie dans une procédure devant la Cour de cassation peut connaître les phases essentielles de l’instruction et du jugement de l’affaire qui la concerne et qui sont décrites dans cette brochure : dépôt des mémoires, fin de l’instruction et distribution à une chambre, désignation d’un conseiller rapporteur, désignation d’un avocat général, date de l’audience de jugement et date du prononcé de l’arrêt. Chaque partie peut également être informée du contenu du rapport et du sens de l’avis écrit de l’avocat général ainsi que de la décision rendue. »
Cette obligation de clarté et d’information n’a pas été respectée par la cour de cassation.
Nous constatons par ailleurs, en consultant les dossiers suivis par les présidents de chambres, que le 27 novembre 2013, Mr Lacabarats a traité 30 dossiers. Certes, les décisions font suite à des audiences préalables, mais l’activité du président semble erratique si l’on consulte le nombre de dossiers traités
Décembre : 43 dossiers traités, 30 dossiers le 18, 6 le 17, 1 le 13, 1 le 10, 5 le 4
Novembre : 92 dossiers traités, 30 dossiers le 27, 7 le 26, 8 le 20, 19 le 14, 10 le 13, 18 le 6
La charge de travail semble peu compatible avec une bonne administration de la justice
MANQUE D’INFORMATION ET DELAI NON RAISONNABLE DU TGI
La Cour Européenne des Droits de l’Homme énonce dans son article 13 que :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Ne pas transmettre officiellement la décision de justice à la partie civile la prive d’office de ce recours et ce d’autant qu’elle n’a pas droit de contester l’action publique.
Ce fut le cas me concernant, ne pouvant me déplacer à Nanterre, je n’étais pas en possession de la décision me concernant au premier chef.
Je n’ai été informé officiellement qu’à ma demande expresse par courrier simple reçu le 12 janvier.
La Cour Européenne précise d’autre part que les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (Vocaturo c.Italie, §17) que soit en jeu le licenciement qu’il conteste (Buchholz c.Allemagne §52;Frydlender c.France[GC],§45),sa suspension(Obermeier c.Autriche, §72),sa mutation(Sartory c.France, §34)ou sa réintégration (Ruotolo c.Italie, §17), ou qu’il y ait un enjeu financier capital (Doustaly c.France,§48)
Bonjour,
Si la décision de la cour de cassation vous semble entachée d'une erreur matérielle (et non de droit ou de procédure), vous pouvez la resaisir pour demander rectification. Seule la Cour de cassation a compétence pour corriger ses propres arrêts.
Je vous conseille de prendre l'avis d'un avocat au conseil d'état et à la cour de cassation, seul compétent pour agir en matière prud'homale devant la Cour de cassation.
__________________________
Cordialement.
bjr,
quand la cour de cassation a rejeté un pourvoi, l'affaire est terminée.
même une décision de la cedh ne peut remettre en cause sa décision, elle peut simplement condamner la france à dédommager le requérant pour viol de la convention.
cdt
une autre question : les procédures civiles et administratives sont étroitement imbriquées et j'ai des griefs sur les 2 tableaux.
Je voudrais faire une action auprès de la CEDH.
Sachant que la décision finale administrative est intervenue le 1/8/2013 notifiée par courrier du 9/8/2013, doit on faire 2 procédures distinctes pour éviter que l'administratif soit rejeté car trop tardif ? Le délai de saisine est il dans ce cas le 1/2/2014 ou le 9/2/2014 concernant la décision administrative?
Merci de votre réponse
Pour répondre à juriste-social, mon avocat en cassation , Maître Spinosi,ne veut pas demander le rabat d'arrêt pour defaut de procédure qui me semble pourtant flagrant.
Puis je passer outre et interroger directement le premier président de la cour de cassation.
J'ai lu qu le rabat pouvait être demandé ou provoqué d'office par la cour de cassation elle même.
Qu'est ce que je risque à leur demander ?
Votre situation a des points communs avec la mienne
Je suis victime d'une décision de rejet de la cour de cassation, basée sur faux motif de mon recours aux prud'hommes et d'appel du Mémoire Ampliatif de mon avocat
Cette situation ne motive aucun avocat à une action en justice contre un avocat
Vos commentaires seront appréciés
Cordialement
Gérard Motsch
Votre cas présente des points communs avec mon affaire que j'ai présentée sur ce forum par le lien ci-dessous
https://www.legavox.fr/forum/droit-general/erreur-procedurale-cour-cassation_101107_1.htm
Je vous invite à également, si votre avocat refuse de présenter pour votre compte une requête en rabat d'arrêt, à lui exposer que ce faisant il viole le droit à chacun (justiciable) d'être en la circonstance assisté d'un avocat, quand bien même ne partagerait-il pas votre avis et/ou les chances de succès d'une telle initiative.
Votre avocat n'est censé pas ignorer qu' à ce titre, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, par un arrêt du 30 Juin 1995 n° 94-20302, a annulé la décision du Conseil de l’Ordre qui, pour dire qu’il n’y avait pas lieu à commission d’office d’un avocat à la Cour de Cassation, dans le souhait d’un justiciable de présenter une requête en rabat d’arrêt, avait retenu que la demande de ce dernier d’engager une procédure « hors DES cas où elle est limitativement admise » et « alors de surcroît, que l’irrégularité invoquée n’existait pas, se trouvait dépourvue d’objet. »
Il faut donc dire à votre avocat que s'il viole ce droit fondamental tel qu'acquiescé par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, il devra alors faire son examen de conscience au regard de la déontologie applicable à sa profession, et à laquelle il a normalement fait le serment de ne pas y déroger....
En réalité, certains avocats à la Cour de Cassation, par je ne sais quelle appréhension, refusent à leur client ce droit d'être assisté dans une procédure qu'ils jugent vouée à l'échec, sauf que ce n'est pas à eux de le dire, mais à un juge....(ce qu'ils oublient souvent)
Cordialement
Modérateur
bonjour,
Le client est libre de confier son affaire à l’avocat de son choix, mais l'avocat est également libre d’accepter ou de refuser l’affaire que le client souhaite lui confier.
salutations
Bonjour Youris,
Oui j'acquiesce à ce que vous dites, mais pensez-vous néanmoins, dans le cadre d'une procédure par représentation obligatoire, que le fait de refuser d'ASSISTER un justiciable au motif que l'avocat ne partage le même avis que son client sur les chances de succès de la procédure, soit à l'honneur dudit avocat ?
Ce dernier ne peut en effet dénier la valeur constitutionnelle de ce droit fondamental pour un justiciable d'être assisté par un professionnel, de même qu'il ne peut dénier davantage qu'il appartient aux seuls juges de trancher de qui, entre le justiciable et l'avocat, avait finalement raison.
Un avocat est normalement régulièrement confronté à des jugements qui ne correspondent pas du tout aux chances de succès qu'il avait pronostiquées à son client.
Il devrait donc dans l'autre sens, et dans le cadre d'un examen de conscience, ne pas refuser d'assister un client qui lui paie des honoraires à ce titre...
Il ne faut enfin pas oublier, qu'en exerçant son droit de refus (comme vous le soulignez), il impose indirectement à un de ses confrères qui serait désigné d'office par l'Ordre dont il relève, que celui-ci accepte ce que lui a expressément refusé.
Peut-on trouver cela vraiment moral ?
Imaginons même, par extrapolation, que l'ensemble des avocats rattachés à l'Ordre et désignés d'office, refusent tous d'assister le justiciable sur les mêmes motifs que le premier avocat, comment pourra être exercé le droit du justiciable ?
Nous sommes donc bien face à un examen de conscience
Modérateur
au contraire, le refus, par un avocat, de prendre une affaire s'il estime ne pas être capable de la défendre , est une preuve d'honnêteté.
alors qu'accepter de défendre l'affaire d'un client, que l'avocat estime avoir peu de chances de succès, est une tromperie.
d'ailleurs, pour obtenir l'aide juridictionnelle devant la cour de cassation, le bureau d'aide juridictionnelle vérifie si le demandeur a une chance sérieuse d'obtenir la cassation qu'il veut attaquer.
Vous avez utilisé le bon mot Youris
l'avocat ne fait qu"'estimer" les chances de succès d'un dossier.
Quand il pronostique qu'un justiciable a peu de chances de succès à soutenir un litige devant le juge et que ce dernier donne raison au justiciable qui soutient du contraire, trouvez-vous toujours honnête que l'avocat ait néanmoins refusé son assistance à son client, quitte à ce que dernier lui signe alors une décharge (un peu comme chez le garagiste à qui vous demandez contre décharge de monter sur votre voiture une pièce d'occasion)
Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'appartient pas à l'avocat de préjuger de l'issue d'un dossier, le client ne faisant que suivre ou non son conseil. Si malgré ce conseil, le client souhaite passer outre à ses risques et périls, l'avocat ne doit pas néanmoins refuser son assistance, histoire qu'il reste en conformité avec ce principe fondamental qu'est le droit à tout justiciable d'être représenté par un professionnel devant un tribunal.
En refusant cette assistance dans les conditions énoncées ci-dessus, il viole purement et simplement ce droit fondamental, ce qui pour un professionnel du droit, est pour le moins surprenant.
Vous ne répondez d'ailleurs étrangement pas à la question du transfert de son refus d'assistance, vers l'Ordre dont il relève pour que celui-ci désigne d'office un confrère qui devra quant à lui accepter cette assistance, quand bien même ce confrère parviendrait aux mêmes conclusions quant à l'absence ou le peu de chances de succès d'un dossier.
Avouez que l'Ordre ne fait ici qu'appliquer le droit pour une justiciable d'être assisté, à fortiori s'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire.
Modérateur
je maintiens qu'un avocat peut refuser de prendre une affaire et ce n'est pas un refus d'assistance, c'est sa liberté .
de la même manière, il n'a pas à envoyer ce client vers son ordre professionnel pour qu'il lui trouve un avocat, cela doit rester la prérogative du client.
même dans le cas de l'aide juridictionnelle le client choisit son avocat.
l'avocat commis d'office, n'existe à ma connaissance, qu'en matière pénale, et dans certains cas, et c'est le juge qui fait procéder à la désignation d'office d'un avocat.
un avocat, commis d'office,n'est pas nécessairement gratuit et doit être rémunéré par la personne qu'il défend à proportion de ses moyens.
J'ai perdu un jugement en cassation, et l'avocat ma simplement informé par mail que celui-ci était perdu. Je n'ai reçu aucun jugement.
Cela est normal ?
De plus que je suis en mauvais terme avec mon ancien avocat qui ma mal défendu ?
Nouveau
Votre diagnostic juridique Gratuit avec un avocat près de chez vous pendant 20 minutes
Sans condition, ni obligation d'achat
Consulter
Consultez un avocat
www.conseil-juridique.net